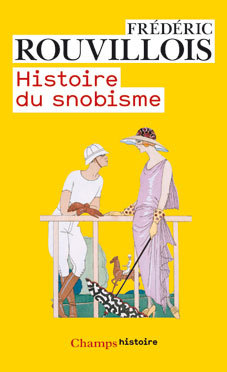
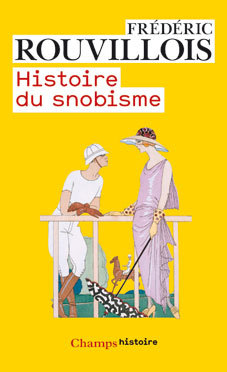
Pour autant, ces comportements, que l’on retrouve dans de multiples microsociétés, datent de bien plus longtemps. « Le snobisme semble avoir existé, quoique sous des formes atténuées, dès le lundi de la semaine qui suivit celle où Dieu créa l’univers », déclare ainsi l’Américain Joseph Epstein dans son ouvrage Snobbery, the American Version (2002), cité par Frédéric Rouvillois.
Si l’on en trouve des traces dès « l’Empire des Césars », le snobisme réapparaît en fanfare à partir de la Renaissance. Il est signalé pour la première fois au XVIe siècle par un chroniqueur genevois, Bonnivard, qui se moque de la « course à la particule », une pratique qui perdurera jusqu’au XXe siècle, chez les nouveaux riches comme chez les intellectuels (M. de Voltaire, né François Marie Arouet) et les hommes de pouvoir (Jean-Baptiste Colbert a lui aussi joué les bourgeois gentilshommes). La Révolution marque une pause, mais ce type de vanité reprend rapidement ses droits, moqué… par d’autres snobs, véritables dépositaires « du bon sens » et de « la règle » (Bachelin-Deflorenne, XIXe siècle). La distinction sociale ne constitue pas l’unique manifestation du snobisme : anglomanie, présence dans le Bottin Mondain, le Who’s Who et les clubs distingués, course aux décorations, affiliation religieuse et spirituelle, fausse rébellion ou encore orgueil intellectuel (particulièrement savoureux) en font également partie. « Plus une idée paraîtra incompréhensible au commun des mortels, plus le snob se sentira dans son élément, manifestant par sa présence et son approbation enthousiaste la supériorité de son esprit comme son indiscutable appartenance à l’élite », écrit ainsi Frédéric Rouvillois à propos du snobisme intellectuel.
Et aujourd’hui ? Si Histoire du Snobisme ne traite pas précisément la question, le lecteur décèle une intemporalité dans la plupart des snobismes exposés, qui ont pour points communs un sentiment de supériorité – plus ou moins marqué – et une certaine forme d’ignorance. De nos jours, les snobs sont toutefois moins moqués. Le snobisme apparaît même comme un « défaut sympathique et dont on n’a pas à rougir ».
Finalement, il est devenu commun.









