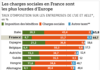Les pessimistes redoutaient un « sommet pour rien », dans le sillage du fiasco de la conférence de Copenhague, un an plus tôt. Le volontarisme des pays émergents en a décidé autrement. L’accord conclu le samedi 11 décembre au sommet de Cancun (Mexique) au terme de la 16e conférence des Nations unies sur le climat a jeté les bases d’un futur traité international sur le changement climatique. « Nous avons démontré que le multilatéralisme peut produire des résultats », s’est félicitée la commissaire européenne à l’Action pour le climat, Connie Hedegaard, qui présidait le sommet de Copenhague en 2009.
Dans la capitale danoise, en 2009, les 194 États membres ne se sont entendus que sur un vague projet sans objectifs chiffrés alors qu’ils visaient un traité contraignant. Plus modeste, l’accord du sommet de Cancun n’en demeure pas moins novateur.
En premier lieu, il intègre l’objectif de limiter le réchauffement climatique planétaire à
2 °C par rapport à l’époque préindustrielle. Cette référence avait déjà été acceptée par les pays du G8, mais refusée jusque-là par les grands pays émergents jusqu’à l’accord de Copenhague. L’enjeu est d’importance : les efforts des pays riches ne suffiront pas à atteindre cet objectif.
La décision du sommet de Cancun prépare cette limitation en affirmant que les pays émergents agiront de façon à infléchir la tendance à la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Des actions répertoriées par le secrétariat de la Convention de l’ONU. Mieux, une procédure « de contrôle et de vérification » sera mise en œuvre sur la base d’une proposition indienne. Cette proposition, formulée par le troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre, a été un des éléments du succès du sommet de Cancun en recueillant le soutien de la Chine, pour qui cette question de contrôle était très sensible.
Pour emporter cette décision, les pays développés ont satisfait les exigences des pays émergents sur deux points. D’une part, ils ont réaffirmé la légitimité du processus de Kyoto. Signé en 1997, il oblige une quarantaine de pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2 % par rapport aux niveaux de 1990 durant une période de cinq années allant de 2008 à 2012. L’accord de Cancun dit que les pays tenteront « de mener à bien » les travaux sur la prolongation du protocole de Kyoto « dans un avenir aussi proche que possible et dans un délai garantissant qu’il n’y ait pas d’interruption entre la première et la deuxième période d’engagement ».
D’autre part, la création d’un « fonds vert du climat », dirigé par un conseil d’administration de 24 membres dans lequel pays riches et pays pauvres seront
représentés à parts égales et doté de 100 milliards de dollars (75 milliards d’euros) par an à partir de 2010 a été entérinée. La gestion de ce fonds sera assurée par la Banque mondiale.
L’accord de Cancun comporte d’autres volets sur l’adaptation au changement climatique, le transfert de technologie propre et la déforestation. Surtout, il permet de rendre crédible la perspective d’un traité international sur le climat lors de la prochaine conférence prévue à Durban, en Afrique du Sud, en 2011.