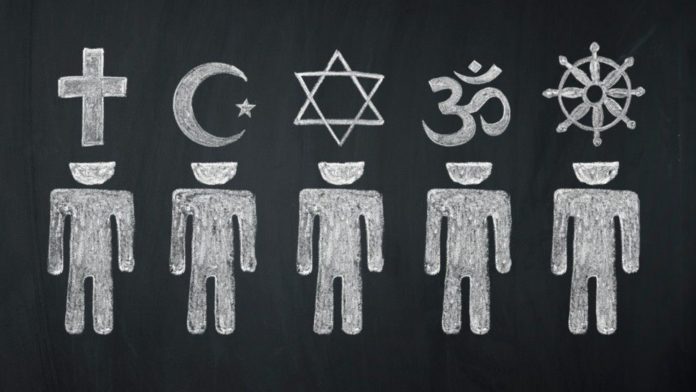
Aujourd’hui la manifestation la plus courante du fait religieux au sein des entreprises est la demande d’absences pour raison religieuse, devant le port de signes visibles, comme le confirme une étude menée par l’Observatoire du fait religieux en entreprise (OFRE), en collaboration avec l’institut Randstad.
Cette enquête menée via un questionnaire en ligne sur un échantillon représentatif de cadres et de managers s’est déroulée entre mars et juin 2018. C’est donc 1453 questionnaires qui ont été réceptionnés et 1111 qui ont été pris en compte dans l’étude. Les répondants, croyants ou non-croyants, pratiquants ou non-pratiquants, se répartissaient ainsi: catholiques (à 49%), athées (à 27%), agnostiques (à 11%), musulmans (à 8%), protestants (à 3%), juifs (à 2%) et bouddhistes (à 1%).
L’absence dûe au fait religieux, désormais premier signe manifeste
Les demandes d’absences pour fêtes religieuses sont désormais sur la première marche du podium dépassant désormais le port de signes religieux visibles au classement des principales manifestations du fait religieux dans le monde de l’entreprise. C’est ce que constate la dernière étude, publiée mercredi 26 septembre, par l’Observatoire du fait religieux en entreprise et l’institut Randstad. «Contrairement aux années précédentes (2016 et 2017), le port de signes religieux visibles sur le lieu de travail n’est plus la manifestation d’appartenance confessionnelle la plus répandue (19,5%). Il cède la place aux demandes d’absence pour motif religieux (21%)», confirme l’étude.
Comme le souligne l’enquête, les demandes d’absences (comme le port de signes visibles) entrent dans la catégorie des «faits personnels» associés à des comportements individuels qui expriment la religiosité du salarié sans entraver pour autant le fonctionnement de l’entreprise. Ces «faits personnels» se distinguent, de fait, des «faits transgressifs» qui perturbent ou remettent en cause le fonctionnement de l’entreprise (par exemple le refus de travailler avec une femme ou sous ses ordres, le refus de réaliser certaines tâches particulières ou bien encore les actions de prosélytisme identifiées…).
Vers une banalisation de la religiosité au travail
L’étude indique que la manifestation de l’appartenance religieuse sur le lieu de travail tend à se «banaliser». Par exemple «2 employés sur 3 (65%) déclarent observer des faits religieux dans leur contexte professionnel (…) Ce taux est inchangé depuis trois ans et confirme que le fait religieux est devenu une réalité banale de l’entreprise», comme l’indique l’étude. Fait notable, la part des salariés qui observent des faits religieux «régulièrement» diminue de 4,5 points par rapport à 2017 (29,5% en 2018 contre 34% en 2017).
Le fait religieux au travail serait «peu perturbateur»
Autre information importante, dans la très grande majorité des cas la religion ne pose pas de difficultés manifestes. Plus de 90% des situations marquées par le fait religieux au cœur de la collaboration professionnelle n’engendreraient pas de situation conflictuelle ou de volonté d’arrêter le travail. «Dans la grande majorité des cas, le fait religieux en entreprise est peu perturbateur et les interactions entre collègues et avec le management qu’il suscite sont apaisées. Dans une minorité d’entreprises il reste problématique et confronte tant les managers que les salariés qui expriment leur foi à des tensions et des conflits», souligne Lionel Honoré, professeur des Universités et directeur de l’OFRE. La part des cas considérés comme conflictuels (9,5%), est cependant en légère hausse par rapport à 2017 (7,5%), tout en restant pour l’instant encore minoritaire.
En outre, les cas liés à des faits religieux qui réclament une intervention managériale sont en hausse (51%) alors que l’on pouvait constater une stabilisation de ce cas de figure ces deux dernières années (48% en 2016 et 47% en 2017). «Une intervention managériale ne consiste pas systématiquement à résoudre des problèmes ou des conflits. Elle peut aussi prendre la forme de la recherche de compromis ou d’une décision acceptée par le salarié». Sur la totalité des interventions managériales, 82,5% ont peu d’incidences sur la bonne marche de l’entreprise, tandis que 17,5% sont des situations «bloquantes». Des cas problématiques et conflictuels qui progressent de façon continue depuis 2013.
La religion, une source de conflit moins évidente que le travail et la politique
Cette étude de l’OFRE et de l’institut Randstad met en avant que la religion est un sujet bien moins conflictuel que le travail en soit, ou des opinions politiques et/ou idéologiques. «C’est le travail lui-même, ses conditions et les revendications qui y sont associées, qui est le plus fréquemment générateur de conflits et de blocages», précise l’étude. En effet 35% des salariés interrogés pour cette étude font mention de situations de conflictuelles liées au travail, de façon régulière. Ils sont 16% à mentionner cette même récurrence de conflits liés à des opinions politiques ou idéologiques. Au final le taux de salariés observant régulièrement des situations de blocage liées à la religion n’est que de 5%.










